L'histoire de Biovallée
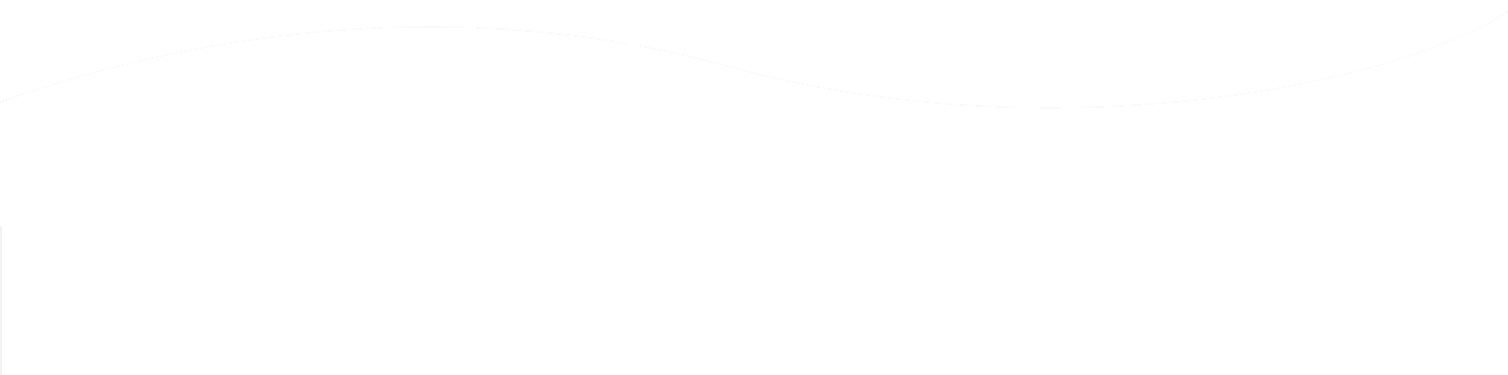
Née au cœur d’un territoire rural marqué par l’exode agricole, l’histoire migratoire, une culture de l’accueil, une rivière sauvage malmenée, et l’aspiration à un autre rapport au vivant, Biovallée est aujourd’hui reconnue comme un laboratoire vivant de la transition écologique. Ce succès s’explique par la capacité de ses habitants, élus, agriculteurs, entrepreneurs, associatifs, à se rassembler et à s’organiser autour de biens communs. Une culture de la coopération qui s’exprime à travers chaque étape fondatrice de la Biovallée : la restauration de la rivière Drôme, l’essor de l’agriculture biologique, la structuration de la filière des plantes aromatiques et médicinales, les grands projets de territoire et l’émergence d’une façon d’entreprendre innovante durable.
Une tradition d’accueil
Depuis l’Antiquité, la vallée de la Drôme cultive sa tradition d’accueil. Sa proximité avec la vallée du Rhône en a fait un axe de passage important, favorisant l’installation de nombreux migrants et voyageurs : les Voconces dans l’Antiquité, les Protestants en 1685, des Italiens et des Espagnols fuyant les guerres civiles, les résistants en 1945… Plus récemment, ce sont des néoruraux venus des grandes villes qui ont contribué à la redynamisation du territoire, alors frappé par l’exode rural.
Nettoyage de la rivière
Dans les années 1980, la rivière est dans un état préoccupant, dénaturée par les prélèvements massifs de graviers pour les chantiers de construction alentour, notamment l’A7, polluée par les rejets d’effluents industriels, de gravats et les nombreuses décharges sauvages et municipales. Elle est alors interdite à la baignade sur la majorité de son cours. Pour alerter sur la situation, des habitants s’enchaînent aux ponts et des associations environnementales tirent la sonnette d’alarme.
Face à cette situation, un programme ambitieux pour restaurer la rivière est alors lancé et un travail de fond est engagé sur 20 ans. Les décharges sont supprimées, des stations d’épuration modernes sont installées dans toute la vallée et les berges sont restaurées pour éviter l’érosion. Ce projet mobilise une large diversité d’acteurs, des élus aux associations locales en passant par les scientifiques et aussi de très nombreux citoyens et citoyennes.
En 1997, la Drôme devient le premier territoire en France à rédiger et signer un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : un outil réglementaire destiné à garantir une gestion durable des ressources en eau.
Grâce à ces efforts, la rivière retrouve progressivement son état naturel. En 2004, la Drôme reçoit le Riverprize international, seul prix mondial récompensant les projets exemplaires de gestion des cours d’eau. Aujourd’hui, elle est l’une des rares rivières d’Europe encore libre de tout barrage sur la quasi-totalité de son cours, et la baignade y est redevenue possible.

L’essor de l’agriculture biologique
Parallèlement à la reconquête de la rivière, un autre changement s’amorce : celui des pratiques agricoles.
Dans les années 70-80, un nombre croissant d’agriculteurs – anciens comme nouveaux – basculent vers l’agriculture biologique.
Face au modèle productiviste dominant, tous les acteurs du système alimentaire s’organisent pour structurer une véritable filière bio : agriculteurs, coopératives, chambre d’agriculture, Conseil général, centres de formation... Ce modèle collaboratif permet de surmonter des freins techniques et sociaux, tout en diffusant largement les savoirs agroécologiques.
Ensemble, ils comprennent qu’en prenant ce tournant ils peuvent passer du statut d’arrière-pays de la modernisation agricole, à un statut d’avant pays d’une époque où on attend de la qualité.
A la fin des années 80, de nombreuses structures qui deviendront par la suite importantes et emblématiques de ce changement émergent : Agribiodrôme (1987), la Carline (1989), et notamment dans la filière des plantes à parfum aromatique médicinal (PPAM) : Sanoflore (1986), l’Herbier du Diois (1987)
Faire territoire
Dans les années 2000, les élus locaux prennent la mesure de ce qui est en train de se construire. Les intercommunalités s’allient pour faire émerger un véritable projet de territoire, en concertation avec les citoyens à travers les conseils locaux de développement (CLD). Au début, ce sont des actions ponctuelles qui s’organisent, comme la création du festival de l’écologie à Die. En quelques années, les liens se créent, la dynamique prend forme. En 2009, le nom Biovallée est officiellement utilisé pour la première fois quand les 3 intercommunalités candidatent ensemble au programme régional, Grand Projet Rhône Alpes (GPRA). L'esprit coopératif de la vallée est alors récompensé : le projet dote la vallée de 10 millions d’euros de subventions régionales. Cette enveloppe va permettre l’émergence et le lancement de 191 projets emblématiques, innovants et précurseurs, pour un montant total de 35 millions d’euros. 78% des projets sont portés par des collectivités. En moins de 10 ans, ce sont ainsi plus de 300 actions de développement durable qui sont mises en œuvre et recensées dans un observatoire.
.

Création de l’association Biovallée
Parmi les actions du GPRA figurent la création et le démarrage d’une association qui a vocation à faire perdurer la Biovallée au-delà de la période du GPRA. L’association Biovallée voit le jour en 2012. Son objet initial est la promotion et la gestion de la marque Biovallée déposée en 2002 par la Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée.
Aujourd’hui, l’objet social de l’association et ses missions ont évolué. L’association Biovallée se positionne comme catalysatrice de coopération entre acteurs engagés, au service de la transition écologique du territoire.
![]()
Territoire d’innovation Biovallée
Après le GPRA, les acteurs du territoire arrivent à nouveau à se mobiliser pour répondre collectivement à un plan grand d’investissement : "Territoires d’Innovation", un programme lancé par l’Etat, opéré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Et c’est à nouveau un succès !
Le programme « Territoires d’innovation – Biovallée », retenu par l’État en 2019 parmi une vingtaine de projets lauréats, s’inscrit dans une stratégie nationale visant à soutenir des territoires capables d’expérimenter des solutions innovantes au service de la transition écologique, économique et sociale. L’État attendait des candidatures qu’elles démontrent une forte capacité à mobiliser les acteurs locaux, à articuler innovation technologique et transformation des modes de vie, et à proposer un modèle réplicable ailleurs. La Biovallée a été sélectionnée pour la richesse de son écosystème local engagé dans la transition, avec plus de 160 porteurs de projets impliqués. Doté de 18,3 millions d’euros sur dix ans, le programme soutient encore aujourd’hui des actions concrètes autour de l’agriculture durable, des énergies renouvelables, de l’économie circulaire, de la mobilité douce ou encore de l’éducation à l’environnement, avec pour ambition de faire de la Biovallée un laboratoire vivant d’un développement soutenable et reproductible.
Aujourd’hui, Biovallée ne se contente plus d’être un territoire de transition : elle aspire à devenir un territoire de régénération.
Les réflexions s’élargissent : comment régénérer les cycles de l’eau, la fertilité des sols, la biodiversité ? Comment s’inspirer du vivant dans nos manières d’habiter, de produire, de décider ? C’est le champ du biomimétisme, des solutions fondées sur la nature, mais aussi du lien au vivant dans notre culture et nos représentations.
Le chemin est encore long, mais l’élan est là, porté par celles et ceux qui choisissent de vivre et d’agir ensemble
